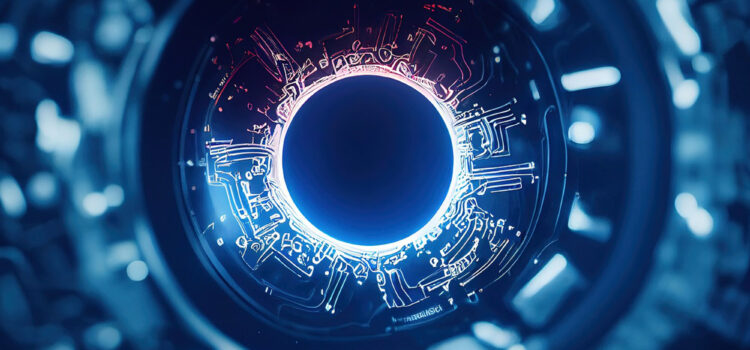Cette course effrénée à la technologie aura pour conséquence évidente de creuser l’écart entre les nations riches et les pays les moins développés. Dans ce contexte, il est aberrant de voir que les décideurs politiques n’aient pas anticipé ce phénomène, en proposant notamment un modèle économique alternatif, capable de surmonter les difficultés qu’engendrera la relocalisation de certaines entreprises étrangères, notamment françaises. Ce sont en effet des milliers d’emplois qui sont susceptibles de disparaître dans les années à venir, entraînant avec eux une baisse de la consommation des ménages, une diminution des recettes de l’État, une perte du lien social, un effondrement de la santé physique et psychique, une hausse de la délinquance et de la criminalité.
Devant l’ampleur du désastre qui s’annonce, nous devons collectivement adopter une attitude responsable et mettre en commun nos expertises respectives afin d’aboutir à des solutions optimales et concrètes pour tous les citoyens Malagasy. À chaque problème sa solution. Mais pour obtenir des résultats favorables, il est absolument nécessaire d’avoir une réelle volonté politique.
Je tiens d’ailleurs à mettre en garde tous ceux qui, par un excès de naïveté, pensent qu’eux seront sauvés du désastre annoncé. La réalité est que nul n’échappe à un destin collectif, quel que soit son statut social ou encore son niveau de vie. Si Madagascar devait s’écrouler sous le poids des tensions sociales dues à une absence d’anticipation de nos dirigeants, c’est la vie de chacun qui sera profondément et durablement affectée.
C’est pourquoi, il nous faut bâtir un nouveau modèle de société fondé sur des valeurs humaines et morales, et qui est capable d’anticiper et de s’adapter aux bouleversements qu’impliquent les innovations.
Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !
Gianni Rakotonanahary

Le nationalisme économique comme rempart solide de la souveraineté
Née aux XVIIe et XXVIIIe siècles, sous l’influence des philosophes des Lumières, le libéralisme économique présente des avantages indéniables. Il a non seulement favorisé une forte croissance économique dans les pays qui l’ont adopté mais a aussi contribué à la prospérité des agents économiques (augmentation des revenus des ménages et de l’investissement des entreprises notamment).
Pour autant, la croyance dans l’autorégulation du marché a ses limites. Force est en effet de constater que le système libéral prive la politique de moyens d’action qui, pourtant, sont indispensables pour favoriser le développement des pays pauvres notamment. Plus grave encore, le libéralisme économique a très largement creusé les écarts entre les plus riches et les plus pauvres dans le monde.
C’est pourquoi, se pose la question de savoir s’il n’est pas plus judicieux de mettre en œuvre une politique keynésienne à Madagascar. Selon cette école de pensée, l’intervention de l’État dans l’économie est nécessaire pour permettre une croissance solide et durable, et ainsi atteindre le plein emploi. Bien qu’elle soit souvent tenue responsable de l’augmentation de la dette publique, du déficit public et de l’inflation, il n’en demeure pas moins vrai que la politique keynésienne a fait ses preuves, tout particulièrement pendant la période des trente glorieuses, période s’étalant des années 50 à la fin des années 60 et pendant laquelle la grande majorité des pays occidentaux connurent une très forte croissance économique et à l’issue de laquelle elles sont entrées dans l’ère de la société de consommation.
Madagascar étant un cas particulier, il me semble inopportun de devoir faire le choix entre ces deux systèmes économiques. À mon humble avis, le mieux serait de les combiner pour, in fine, aboutir à une forme de nationalisme économique. Ce nationalisme économique serait fondé sur une protection des entreprises nationales contre les entreprises étrangères (patriotisme économique), tout en favorisant le libre jeu de la concurrence entre les entreprises locales.
L’État se chargerait par ailleurs de l’exploitation des ressources naturelles du pays, de la construction des infrastructures indispensables au développement économique (routes, hôpitaux, établissements d’enseignement etc.) et assurerait ses fonctions régaliennes comme la création de la monnaie, la sécurité extérieure avec l’armée, et la sécurité intérieure avec la police et la justice.
Un fonds souverain serait par ailleurs mis en place pour permettre aux autorités d’investir dans des startups et dans la construction de complexes hôteliers et des résidences de standing pour les retraités étrangers qui viendraient s’installer à Madagascar.
Pour finir, il me semble indispensable de faire de Madagascar une zone à fiscalité réduite, voire nulle. C’est très certainement la meilleure solution pour susciter l’intérêt des investisseurs étrangers.
Le système proposé n’est évidemment pas entièrement abouti et fera naturellement l’objet d’un perfectionnement dans le cadre du think tank dont j’ai la charge.
Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !
Gianni Rakotonanahary

Le tourisme de masse : une menace pour Madagascar
Le manque flagrant d’infrastructures touristiques est non seulement un frein au développement de ce secteur d’activités, mais il constitue également un vrai défi, tant il peut constituer un pilier de la croissance économique de Madagascar.
Pour autant, gardons-nous de succomber aux sirènes du tourisme de masse qui fait des ravages partout où il s’installe. Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre dans ces pays qui ont fait le choix de ce modèle de développement touristique. Là-bas, les habitants étouffent et sont excédés par les nuisances sonores que génère le flux de vacanciers. Les sites naturels subissent les assauts incessants de touristes sans vergogne.
Les dégâts engendrés par le tourisme de masse incitent certains pays à abandonner ce modèle touristique pour se tourner vers un tourisme dit « durable ». Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) il s’agit d’un tourisme « qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil ».
C’est précisément le chemin que devrait emprunter Madagascar pour préserver son écosystème. Nous devons cibler les touristes dont la motivation principale est d’observer et d’apprécier notre biodiversité, et ce, dans le respect de notre culture et de nos traditions.
Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !
Gianni Rakotonanahary

Quelles infrastructures touristiques pour Madagascar ?
Les infrastructures touristiques regroupent l’ensemble des installations nécessaires à l’accueil des vacanciers, ainsi que les institutions et organismes touristiques associés. Ces infrastructures constituent un facteur clé du développement du tourisme.
Ce déficit en infrastructures touristiques est d’autant plus inquiétant que le tourisme, et tout particulièrement le tourisme dit “durable”, est un secteur économique qui favorise à la fois la croissance économique et le développement d’un pays.
C’est pourquoi, l’État malgache, en partenariat avec le secteur privé, devra s’engager non seulement à moderniser les différentes infrastructures touristiques existantes mais aussi à développer de nouvelles infrastructures fonctionnelles et efficaces.
Parmi les infrastructures utiles, figurent en premier lieu les ouvrages au sol ou en sous-sol nécessaires au transport et aux voies de communication. Ainsi en est-il, par exemples, des autoroutes, des routes, des lignes ferroviaires, des tramways, des voies navigables, des ports maritimes, des véloroutes et des voies vertes… Je félicite d’ailleurs le gouvernement malgache d’avoir signé le contrat portant sur la construction de la première autoroute du pays qui reliera la capitale Antananarivo à Toamasina.
Il me semble également nécessaire de construire de nouveaux hôtels de standing ainsi que des hébergements insolites pour attirer une clientèle touristique huppée et les amateurs d’exotisme.
Il serait par ailleurs judicieux de la part des collectivités locales, en association avec les entreprises privées, de mettre en place des routes et circuits de découvertes touristiques, des offres de séjours et d’itinérances dans le périmètre direct des fleuves, rivières et canaux.
Enfin, pour devenir une destination touristique crédible, il me semble utile de créer des parcs et jardins historiques, botaniques et paysagers, et de mettre en place des attractions de type culturel, naturel ou récréatif dans les villes emblématiques de Madagascar.
Pour conclure, la réussite d’une politique du touristique suppose avant tout la création d’infrastructures modernes et efficaces. Mais pour autant, il est fondamental de prendre en considération les enjeux sécuritaires. La santé et la sûreté des voyageurs sont des aspects essentiels du succès ou de l’échec d’une destination touristique.
C’est pourquoi, il est urgent pour le pays de s’attaquer au problème de la violence et de la délinquance qui gangrènent les villes et les campagnes malgaches.
Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !
Gianni Rakotonanahary

Les investissements en infrastructures de réseaux
L’histoire de l’humanité se caractérise par une succession d’inventions et de découvertes qui, pour certaines d’entre elles, ont profondément bouleversé nos vies. Aujourd’hui plus qu’hier, les pays industrialisés investissent massivement dans la recherche et développement afin de s’octroyer un avantage concurrentiel : En 2020 par exemple, Amazon n’a pas hésité à dépenser près de 43 milliards de dollars, soit environ 11 % de son chiffre d’affaires. Les autres géants du Web (Google, Apple, Meta et Microsoft) ne sont pas en reste. Les grandes entreprises qui œuvrent dans le secteur automobile et pharmaceutique (Volkswagen, Intel, Roche et Johnson & Johnson) s’évertuent elles aussi à consacrer une part non négligeable de leurs revenus en R&D.
Toutes les études le confirment, dans un contexte de concurrence accrue, l’investissement constitue l’un des éléments clé de la survie et de la croissance des entreprises. Le retour en force de l’analyse keynésienne dans les pays développés, par exemple aux États-Unis, remet au goût du jour l’idée selon laquelle la dépense publique, notamment en infrastructures (transports, énergies et technologies de l’information et de la communication (TIC)), peut exercer un important effet d’entraînement sur l’investissement privé. Ceci est d’autant plus vrai que les dépenses en infrastructures favorisent l’attractivité du pays et renforcent sa capacité productive.
Madagascar ne doit pas rester en marge de toutes considérations technologiques. Pour assurer une croissance durable et inclusive, il lui faut consacrer une part significative de son PIB en infrastructures de réseaux. C’est là une condition essentielle pour qu’il puisse échappe à son statut de pays pauvre, vulnérable, en proie à la crise climatique et aux inégalités extrêmes.
Que Dieu bénisse le peuple malgache et protège notre Nation !
Gianni Rakotonanahary